Artikle: Kenya: Matata ebimi mpo na bolukiluki ya siansi mpe ntomo ya bato ya mboka

Kenya: Matata ebimi mpo na bolukiluki ya siansi mpe ntomo ya bato ya mboka
Etumbu oyo euti kozwama ya bato mibale ya mayele na makambo ya bomoi ya Belgique mpo na misala oyo etali bolukiluki ya bikelamu ndenge na ndenge na Kenya ebimisi mobulu na kati ya bato ya siansi mpe na mikili mosusu. Wana bamekaki kotala bozwi ya ekolo ya écologie, lolenge na bango elimbolamaki lokola kobuka ntomo ya mboka, mpe yango ebimisaki ntembe makasi na ntina ya bosembo, bizaleli malamu, mpe limemya mpo na mimeseno ya bato ya mboka. Nini esalemaka soki science ekutani na ba réalités sociopolitiques ya mboka moko?
Bato ya mayele na makambo ya bomoi oyo bafundamaki: likambo oyo ezali kotungisa
Bato yango ya mayele na bioloji, oyo bazalaki koluka biloko oyo emonanaka mingi te mpo na kopesa makasi na bolukiluki na bango, bamimonaki na katikati ya mopɛpɛ makasi ya bapanzi-nsango. Mikano na bango, atako emonanaki lokola ya lokumu, bato mosusu bamonaki ete bazalaki kosalela biloko oyo ezali na Kenya. Ekólo yango, oyo ezali na bikelamu ndenge na ndenge ya kokamwa, ezali kokutana na mikakatano minene mpo na ezingelo, mpe kobatela libula na yango ya bozalisi ezali kokóma na ntina mingi. Kasi, na ntalo nini? Bozwi ya makoki ya bioloji etambwisami na mibeko ya makasi, mpe ezali na bozangi bondimi palpable na bapaya oyo bayaka "kozwa" kozanga kopesa eloko na esika na yango.
Réaction ya genoux: tango science ekomi polemique
Lisangá ya siansi ya mikili mingi esalaki nokinoki mpo na kokweisama yango. Mpo na mingi, ezali kolamuka, likebisi mpo na balukiluki oyo balingi kotala bitúká ya Afrika. Ezali kobimisa mituna ya ntina mingi: Bato ya siansi bazali mpenza na lotomo ya kozwa bikelamu ndenge na ndenge ya bikólo mosusu? Nani abatelaka makoki ya mikili oyo eyambaka bango na bibongiseli oyo ezali koluka kozwa ndingisa ya kosala biloko oyo bamoni? Nkanda yango euti kaka na bakonzi ya Kenya te, kasi mpe na bato ya siansi, oyo ezali kotya ntembe na bizaleli malamu ya ndenge wana.
Vers un paradigme ya sika ya collaboration
Longola bondimi ya ba Belgiques mibale, likambo oyo ekoki mpenza kozala libaku ya mbongwana na lolenge bolukiluki esalemi mpe esalemi na Afrika. Lokola Kenya ezali koluka kolendisa mibeko na yango mpo na bozwi biloko mpe bikelamu ndenge na ndenge, ezali na ntina mingi ete bato ya siansi ya mboka bámipesa na misala ya bolukiluki. Kosala elongo, limemya, mpe bokeli elongo ezali maloba ya bokengeli oyo esengeli kotambwisa misala ya siansi oyo ekosalema na mikolo mizali koya. Balukiluki ya bapaya basengeli kososola ete bazali babikisi te, kasi bazali baninga na écosystème moko ya mindondo mpe oyo ezali na boyokani.
Na mokuse, likambo oyo ya ba biologistes belges ezali kolamuka : esengeli te science ezala excuse mpo na konyata makoki ya bikolo mpe ya bato. Na kosalaka elongo, na molimo ya bosangisi mpe ya limemya, tokoki kosala ete mikolo mizali koya ezala esika wapi bolukiluki ya siansi mpe bomoi ya bikelamo ndenge na ndenge ekozala elongo na boyokani.
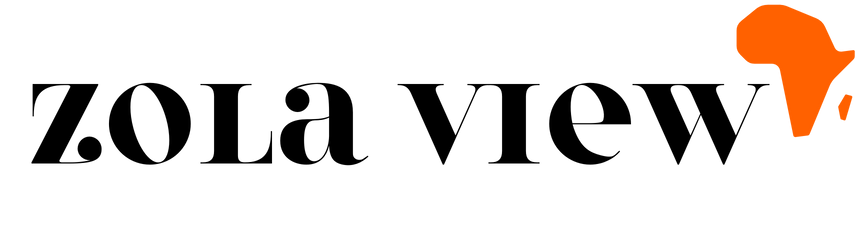


Botika commentaire
Ce site est protégé par hCaptcha, et la Politique de confidentialité et les Conditions de service de hCaptcha s’appliquent.