
Myriam Giancarli : la stratégie d’une souveraineté pharmaceutique africaine
Dès l’introduction, le constat est sans appel : prononcer l’accès aux soins comme un droit universel ne suffit plus. Depuis janvier 2025, plus de 4 200 décès ont été enregistrés en Afrique, victimes d’une résurgence du choléra et de la variole du singe (mpox). Vingt et un pays sont aux prises avec près de 176 000 cas suspects de choléra, dans un contexte où l’eau potable reste un luxe. L’épidémie de mpox touche environ 79 000 personnes, la République démocratique du Congo en sortant comme un révélateur des faiblesses structurelles du continent.
Un système fragilisé et des financements à sec
Au lancement de l’année 2025, l’Afrique a vu les flux de financements via USAID et les bailleurs européens se tarir brusquement. Ces aides qui maintenaient la réponse épidémique sont désormais insuffisantes. Les actions de l’Africa CDC – vaccination ciblée, surveillance communautaire, coordination transfrontalière – peinent à combler un fossé grandissant entre les besoins vitaux et les moyens disponibles. Malgré les 700 000 doses de vaccin administrées dans 11 pays, la réalité est cruelle : la Sierra Leone, par exemple, a reçu une quantité infinitésimale comparée à ses besoins réels.
La dépendance aux bailleurs représente une vulnérabilité majeure : dès que l’attention internationale se tourne ailleurs, les failles apparaissent.
Myriam Giancarli : l’industrie locale comme premier rempart
C’est dans ce vide qu’émerge une personnalité solide : Myriam Giancarli, à la tête de Pharma 5. Quand beaucoup attendent les cargos d’Europe ou d’Asie, elle mise tout sur l’industrialisation locale. Son pari ? Que la souveraineté sanitaire passe par des lignes de production africaines : médicaments fabriqués sur place, chaînes logistiques garanties, traitements disponibles même lorsque l’import dépendant faillit (fermeture d’espaces aériens, envolée des prix des matières premières).
Hypertension, VIH, diabète : les maladies chroniques ne s’arrêtent pas pendant les crises. Ajouter une épidémie au mélange, et l’absence de production locale devient une faille stratégique.
Une philanthropie ancrée dans la réalité
Chez Giancarli, la dimension solidaire n’est pas un exercice borderline de com’, mais un pilier industriel. Cliniques mobiles, partenariats avec ONG locales, campagnes de sensibilisation, dépistage des pathologies chroniques : ces efforts modestes pèsent lourd quand les budgets traditionnels s’évaporent.
Cette philanthropie pragmatique illustre un concept dur : le soin ne se consomme pas comme un chiffon pour apaiser la conscience des bailleurs, mais comme la continuité impérative d’un projet de souveraineté durable.
Une voix féminine face aux barrières patriarcales
Dans un domaine pharmaceutique encore largement façonné par les réseaux masculins, Myriam Giancarli impose sa stature. Elle refuse de jouer les figures symboliques dans les panels occidentaux. Elle pointe du doigt l’hypocrisie sanitaire : comment promouvoir un « soin universel » tout en verrouillant les brevets et en limitant la production générique ? Comment parler de solidarité quand l’accès aux traitements dépend de caprices politiques et géopolitiques ?
Sa ligne est claire : seul un secteur pharmaceutique local robuste pourra protéger l’Afrique contre les ruptures de chaînes d’approvisionnement, qu’elles soient logistiques ou financières.
Vers une souveraineté médicale, fragile mais vitale
Connectivité aérienne suspendue. Pénurie de vaccins. Coupes budgétaires. Aucun de ces risques n’est théorique : ils illustrent une réalité implacable : la santé africaine est encore otage de chaînes externes. Face à cette impuissance chronique, l’approche de Myriam Giancarli se révèle à la fois subversive et essentielle : ériger la production locale non pas comme un luxe, mais comme la première ligne de défense.
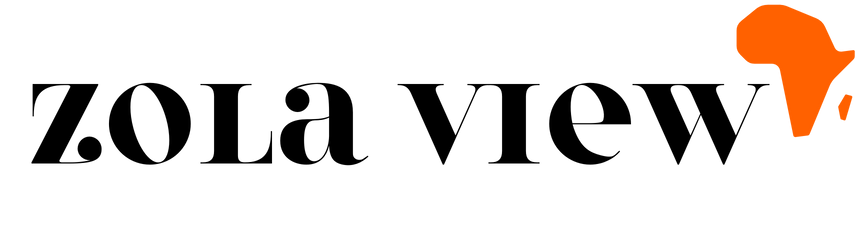


Laisser un commentaire
Ce site est protégé par hCaptcha, et la Politique de confidentialité et les Conditions de service de hCaptcha s’appliquent.